On laissera le Conseil des Anciens et le Tribunat avec les Cinq Cents et le Corps législatif pour ne commencer qu’avec le Sénat conservateur. Et comme la fonction a été monopolisée pendant quarante ans par une seule famille, notre premier chapitre nous conduira jusqu’en 1848…
Sénat conservateur (1799-1814)
Chambre des Pairs (1814-1848)
Au Sénat conservateur, puis à la Chambre des Pairs, c’est Louis-François CAUCHY qui officie, avec le titre de « garde des registres, rédacteur des procès-verbaux des séances ». Ou plutôt les Cauchy car en 1823, le « chevalier Cauchy » a pour adjoint Alexandre Cauchy qui le remplacera en 1830, avec pour second … Eugène Cauchy – le « chevalier Cauchy » étant mentionné à la suite comme garde des registres honoraire !
Chambre des pairs, règlement adopté le 2 juillet 1814
TITRE XI : Garde des registres, officiers ministériels
Art. 84. Il y a un garde des registres chargé de tenir la plume et de rédiger provisoirement le procès-verbal. Il a son siège et sa table dans le parquet.
Art. 85. Il soumet au président et aux secrétaires la rédaction du procès-verbal, et ce n’est qu’après que la rédaction a été approuvée par eux qu’il en est fait lecture à la Chambre, sur l’ordre que lui en donne le président.
Art. 86. Le garde des registres est à la nomination du chancelier président.
TITRE VIII : Procès-verbal de la Chambre.
Art. 68. Le procès-verbal des séances de la Chambre contient l’exposé sommaire des opérations de la Chambre pendant chaque séance.
Art. 69. Les motifs des opinions n’y sont insérés que sommairement ; les opinants n’y sont pas nommés.
Art. 70. Les rappels à l’ordre qui auraient eu lieu dans la séance n’y sont insérés qu’autant que la Chambre l’a expressément décidé, et que sa décision n’a point été révoquée dans le cours de la séance.
Art. 71. Aucun des discours prononcés dans la séance, ni aucune des pièces qui y ont été lues, ne sont insérées au procès-verbal, à moins que la Chambre n’en ait ordonné l’insertion. Il indique seulement le titre ainsi que le numéro d’enregistrement et renvoi, pour les actes et pièces dont la Chambre a pu ordonner le dépôt dans ses archives. Le procès-verbal est signé par le président et deux secrétaires au moins.
Art. 72. Les procès-verbaux de la Chambre des pairs sont imprimés séance par séance pour être distribués aux membres de la Chambre seulement. Les pairs peuvent en tout temps prendre communication des procès-verbaux de la Chambre, ainsi que des pièces déposées aux archives.
Art. 73. Aucun extrait des actes de la Chambre ne peut être délivré que sur l’autorisation du bureau, signée du président et de deux secrétaires au moins.
Louis-François CAUCHY
(Rouen, 1760-1848), avocat, attache sa fortune à l’intendant Thiroux de Crosnes et le suit à Paris lorsqu’il devient lieutenant de police en 1785. À ce titre, aurait collaboré (comme premier commis de police, ou comme secrétaire général ?) à des mesures d’assainissement, telles que la suppression du cimetière des Innocents. Pendant la Révolution, « il se réfugia pour quelque temps, comme dans une retraite, dans les modestes fonctions de chef des bureaux des hospices et ateliers de bienfaisance. On le retrouve, à la renaissance de l’ordre social, attaché à la Commission de l’agriculture et des arts, puis à la tête des mêmes bureaux, lors de la première formation du Ministère de l’Intérieur.
Ce fut là qu’à l’époque du Consulat, plusieurs de ses anciens amis, qui avaient couru la carrière périlleuse des honneurs et qui avaient été compris dans la première liste du sénat, vinrent le chercher pour lui offrir la place de secrétaire général de ce grand corps ; les règlements laissaient alors cette fonction au choix de l’assemblée. M. Cauchy y fut nommé par scrutin, le 1er janvier 1800. Il se trouva, pour son service, sous les ordres immédiats de M. de Laplace, promu dans ce même temps au titre de comte et à la dignité de chancelier du Sénat conservateur. À partir de 1814, M. Cauchy père a continué près de la Pairie, avec le titre de garde des registres et archives, des fonctions analogues à celles qu’il remplissait près du Sénat ; la rédaction des procès-verbaux, confiée à ses soins, prit alors, par l’éclat des discussions politiques, un intérêt tout nouveau. Entouré de considération et d’estime, il a poursuivi jusqu’en 1848 [en fait, 1830] sa carrière si bien remplie de travaux distingués et de bonnes œuvres. » (C. A. Valson, La vie et les travaux du baron Cauchy, Gauthier-Villars, t. I, 1868).
Ajoutons qu’en 1822, il avait été nommé » garde des archives des Ordres du roi » (Saint-Esprit notamment). Napoléon l’avait fait chevalier en 1808 et Charles X l’avait anobli en 1825.
De ses trois fils, le plus connu est l’aîné, Augustin (1789-1847), qui a laissé un nom comme mathématicien. Légitimiste, il suivit Charles X en exil et fut le précepteur scientifique du comte de Chambord (1831-1837). Il reprit son enseignement scientifique à Paris en 1848, refusa en 1852 de prêter serment à Napoléon III mais n’en fut pas moins maintenu dans sa chaire (Dictionnaire Mourre).
Le premier des deux gardes des archives, Alexandre (1792-1857), magistrat, fut aussi conseiller à la Cour de cassation (1849). « Compagnon d’études et l’émule de son frère aîné, il montra lui-même, de bonne heure, des dispositions naturelles pour les sciences mathématiques ; mais pendant que son frère Augustin s’y livrait tout entier, Alexandre se distingua dans l’étude du droit, et, à vingt-cinq ans, les portes de la magistrature s’ouvrirent pour lui dans les conditions les plus favorables (…) Nommé conseiller-auditeur à la Cour royale de Paris, (il) s’y fit bientôt remarquer par la netteté de son esprit, la rectitude de son jugement, la gravité de sa jeunesse. Devenu conseiller à la même Cour en 1824, il y développa, dans la présidence des assises, d’éminentes qualités qui le conduisirent à être nommé président de chambre à la Cour royale en 1847, et conseiller à la Cour de cassation deux ans plus tard. C’est dans cette position élevée que la mort est venue le frapper, le 30 mars 1857. Peu de magistrats ont laissé des regrets plus vifs et plus mêlés d’affection et d’estime. » (C. A. Valson, op. cit.)
Eugène (1802-1877) « fut aussi admis de bonne heure, en qualité de garde des registres adjoint de la Pairie, à partager les fonctions de son père, auquel il succéda dans sa charge en 1831. Il participait en même temps aux travaux du Conseil d’État, d’abord comme auditeur, puis comme maître des requêtes. Il a continué ces doubles fonctions jusqu’à la suppression de la Pairie en février 1848. À partir de cette époque, sa vie a été consacrée tout entière à l’étude du droit public, dans lequel il s’était déjà fait connaître par divers ouvrages, notamment par son livre des Précédents de la Cour des Pairs, publié en 1839, et destiné à devenir comme le manuel de cette haute juridiction. Il avait aussi publié, en 1847, l’Histoire du duel considéré au point de vue de la législation et des mœurs, et ce livre avait été couronné par l’Académie française ; mais une question plus vaste et d’un intérêt plus actuel devait lui fournir bientôt le sujet de son principal ouvrage. En 1854, l’Académie des Sciences morales et politiques avait mis au concours l’Histoire du droit international maritime, dans ses rapports avec les progrès de la civilisation chez les différents peuples. L’ouvrage composé sur ce programme par M. Eugène Cauchy a obtenu, en 1862, le prix proposé, et a valu à son auteur d’être élu, bientôt après [1866], Membre de cette même Académie, dans la section de Législation, Droit public et Jurisprudence. » (Ibid.) » On peut également citer de lui un traité de la propriété communale (1848) et une étude sur Domat (1852)
Mais d’autres se montrèrent moins révérencieux que le biographe Valson :
Nouveau dictionnaire des girouettes (1832) :
CAUCHY, Louis-François : « Commis à l’intendance de Rouen avant la révolution ; garde des archives et du sceau, rédacteur des procès-verbaux du Sénat-conservateur sous le consulat ; secrétaire-archiviste du sénat-conservateur sous l’empire ; garde des archives et rédacteur des procès-verbaux des séances de la Chambre des Pairs sous la restauration ; garde des archives honoraire de la même Chambre avant, pendant et après la révolution de juillet ; son fils Alexandre, conseiller à la cour royale, en étant le garde titulaire, et son fils Eugène, le garde-adjoint, tous trois fort bien logés, éclairés et chauffés au Luxembourg. Poète latin sous le consulat et l’empire, M. Cauchy a publié : Ode au premier consul, 1802 ; Ode à Napoléon sur la rupture du traité d’Amiens par les Anglais, 1805 ; La Légion-d’honneur, ode, 1805 ; Napoléon au Danube, ode traduite de l’italien du colonel Grobert, 1805 ; La Marche de la Grande-Armée, ode, 1805 ; la Bataille d’Austerlitz, dithyrambe, avec une traduction française, 1806 ; les Prédictions de Nérée, petit poëme sur la naissance du roi de Rome, 1811. En récompense de tant de vers latins, Napoléon le fit chevalier de la Légion-d’Honneur. Louis XVIII, pour qui il en composait souvent, le fit officier du même ordre. Charles X, dont il chanta le sacre, poussa ses enfans. Il n’a pas encore chanté Louis-Philippe. Attendons ! ».Eugène Briffault, dans le Dictionnaire de la conversation (1853) :
CAUCHY. Sous le règne de Louis-Philippe, les Cauchy formaient, non pas seulement une famille, mais une tribu, presqu’une dynastie. L’Almanach royal a longtemps constaté la présence de trois Cauchy près de la chambre des pairs ; ils portaient le titre de gardes des registres de la chambre ; c’étaient des tabellions politiques. L’humilité officielle de ce titre importuna les Cauchy ; aussi se laissèrent-ils donner ou bien prirent-ils eux-mêmes le nom de greffier, ou celui de secrétaire rédacteur, selon la circonstance. Les Cauchy avaient encore un autre privilège ; ils naissaient tous chevaliers de la Légion-d’Honneur. Cette race de rongeurs bureaucratiques s’était attachée à la partie élevée du palais du Luxembourg ; là ils avaient formé une colonie ; ils s’étaient identifiés avec ce logis, de telle sorte qu’ils en faisaient eux-mêmes partie. On disait alors que, pour en extirper les Cauchy, il eût fallu démolir l’édifice. Longtemps sur cet asile des patriciens les événements accomplirent leurs révolutions sans rien déranger à la paisible possession des Cauchy. Sur les ruines du sénat-conservateur, sur celles des pairs des Cent-Jours, sur celles de la pairie de Louis XVIII et de Charles X, brisées en 1830, les Cauchy étaient restés debout et sans crainte. L’hérédité de la pairie avait succombé ; mais, au-dessus d’elle, sous les combles du monument, l’hérédité des Cauchy était demeurée inébranlable. Cette succession paraissait devoir se continuer dans un avenir sans fin. Vanitas vanitatum ! Tout à coup vient à sonner l’heure fatale du 24 février 1848. La république est acclamée, et le premier coup de marteau de l’horloge met en fuite les Cauchy, qui ne voient rien de plus incroyable dans cette révolution que leur déménagement forcé du Luxembourg.
Le chevalier Cauchy, mort, heureusement pour lui, quelques mois avant la proclamation de la république, est la souche de tous ces Cobourg bourgeois ; nous n’avons sur lui que des notions vagues et imparfaites ; pour le distinguer de sa descendance, nous dirons que, nourri des traditions du sénat conservateur, M. le chevalier Cauchy avait tour à tour célébré, dans des odes et des dithyrambes, Napoléon, les deux rois de la branche aînée, et qu’il célébra ensuite le gouvernement de Juillet. Nous l’appellerons, nous, Cauchy le Lyrique. Sous le sénat, la charge de rédiger le procès-verbal des séances fut une véritable sinécure. Durant les quinze années de la restauration, la rédaction des discussions de la chambre des pairs, privées de publicité, causait peu de fatigue aux secrétaires. Possesseur de ce fief sénatorial, le chevalier Cauchy appela d’abord auprès de lui un de ses fils, Alexandre CAUCHY, déjà conseiller à la cour royale, qu’il associa à ses loisirs, mais auquel, comme c’était justice, il fit donner des appointements.
La publicité des séances de la chambre des pairs, inscrite dans la Charte de 1830, mit tout en désarroi au Luxembourg. C’en fut fait de l’indolence des secrétaires, de leur mollesse et des délices d’une place presque sans fonctions. Or Alexandre Cauchy, sans avoir complètement et officiellement succédé à son père Cauchy le Lyrique, avait hérité de ses habitudes paisibles et des douceurs de l’emploi ; la redoutable publicité changeait tout à coup cette agréable condition, et la tribune des journalistes forçait le procès-verbal à être une vérité.
Les devoirs nouveaux demandaient peut-être une vigueur juvénile dont les deux Cauchy ne se sentaient pas capables ; aussi bien, certains scrupules s’étaient manifestés en haut lieu sur l’incompatibilité des fonctions judiciaires dont Alexandre Cauchy était investi, avec l’emploi de garde-notes de la noble chambre.
Alors il y eut dans la famille ce cri d’autrefois : Surgat junior ! que le plus jeune se lève ! Et l’on vit paraître aux séances du Luxembourg Eugène CAUCHY qui ne porta d’abord que le titre de garde-adjoint, mais qui devint bientôt titulaire. En effet, devant la nécessité du travail, les deux Cauchy, le chevalier et son fils Alexandre, se retirèrent, et ne conservèrent que le titre ad honores, avec quelques émoluments de retraite.
Eugène Cauchy, appelé tout à coup à remplacer son père et son frère, parut à la chambre des pairs avec les grâces longues et minces d’un jeune héron. N’allez pas trouver cette comparaison malséante; elle n’est que vraie. La famille des Cauchy a son type qui lui est propre ; dans toute leur conformation physique, ses individus rappellent l’aspect de ces grands oiseaux qui habitent les bords des lacs : il y a en eux du palmipède. En regardant attentivement la physionomie de Cauchy le Lyrique, on retrouvait dans les lignes du galbe le caractère du pélican. La timidité d’Eugène Cauchy ajoutait un charme particulier à sa singulière allure : il rougissait en donnant lecture du procès-verbal. Mais ce que n’avaient pu faire pour les honneurs et l’importance de cette place secondaire les deux Cauchy ses prédécesseurs, Eugène Cauchy l’accomplit ; il donna à cette humble charge une autorité que personne avant lui n’eût osé espérer; il comprit que le secrétaire de la noble chambre devait agir comme les secrétaires des grands seigneurs du temps passé, qui savaient si bien se substituer à ceux qui les employaient. Le jeune garde-archiviste s’aperçut tout de suite des velléités suprêmes de M. Pasquier et de son ferme désir de soumettre la Chambre à une discipline rigoureuse et presque à une obéissance passive. Il s’incarna dans le règlement et il devint pour le président un aide de camp utile et intelligent, qui tenait, sans cesse, ouverte devant lui la carte des délibérations ; il fut le bras droit de la présidence. Quand il arrivait que M. Pasquier ne pouvait pas présider la séance, M. Eugène Cauchy était la providence des vice-présidents, fort ignorants de la tenue parlementaire, inhabiles et inexpérimentés à manier le pouvoir et la sonnette. Celui d’entre les vice-présidents qui avait le plus besoin de cette assistance, c’était feu M. Séguier. Ce magistrat qui présidait si cavalièrement au palais de Justice, était gauche et gêné au palais du Luxembourg : il confondait tout et jetait partout le désordre et le trouble. Il ne conduisait la discussion que d’une main faible et incertaine ; M. Eugène Cauchy le soutenait du mieux qu’il pouvait ; il le dirigeait de la voix et du geste, il lui soufflait son rôle ; il arrivait même souvent que le secrétaire, pour mieux se faire entendre, montait sur l’estrade du président, et, en quelque sorte, le menait par la main, pour franchir les pas difficiles. M. Eugène Cauchy, déjà si utile à M. Pasquier, fut ainsi pour les autres un objet d’indispensable nécessité ; sa fortune était désormais assurée : il continuait glorieusement l’œuvre paternelle.
Au labeur de sa besogne législative, M. le garde des archives de la chambre des pairs unissait d’autres travaux ; il était tour à tour greffier de la cour des pairs et employé de l’état-civil, lorsqu’il accompagnait M. le chancelier, officier de l’état-civil de la famille royale. C’était pour ces circonstances solennelles que les deux porte-plume s’étaient fait faire un habit brodé, aux parements et au collet, d’une soie jaune qui faisait tous ses efforts pour ressembler à de l’or. Cette vanité était des plus innocentes ; seulement elle avait le double inconvénient de ne pas atteindre le costume et de friser la livrée. Dans ces circonstances, c’était sur M. Eugène Cauchy que M. le chancelier se reposait du soin de régler le cérémonial de la célébration. M. Pasquier, allant officier en cour pour les naissances, mariages et décès des princes et des personnes augustes, était suivi par M. Eugène Cauchy, qui l’assistait comme le lévite assiste le prêtre à l’autel. Ces jours-là, M. Eugène Cauchy portait l’épée, et sa démarche était fière, lorsque l’étiquette, dont il était le fervent observateur, ne courbait pas son échine. C’était la partie la plus brillante de sa position : aussi ne cédait-il à personne ces prérogatives, qui l’approchaient des hautes régions. D’ailleurs, il y avait un casuel de petits présents et de menues décorations, miettes qui tombaient de la table diplomatique, et qui ajoutaient quelque chose aux attraits de cette place, gloire patrimoniale de la famille Cauchy.
Il y avait aussi un autre côté de la médaille moins brillant, mais dont les profits avaient une solidité et une réalité que n’ont pas toujours les faveurs de cour. Nous voulons parler du greffe de la chambre des pairs, lorsque, judiciairement constituée, elle portait le titre de Cour des Pairs. Le garde des archives, que nous venons de voir occupé à dresser le protocole des actes de l’état-civil pour la famille royale, tenait alors le plumitif de l’audience, véritable maître Jacques, tour à tour réclamé par tous les services du logis, et changeant de ton et de manière selon les hommes et les choses. Sous la présidence de M. Pasquier, qui, dans sa verte vieillesse, se piquait d’une jeune activité, le travail du greffier, qui suivait les débats au courant de la plume, était des plus pénibles ; mais les honoraires accordés à chaque vacation étaient comme le picotin d’avoine, et soutenaient les forces du scribe. Dans l’accomplissement de ses fonctions judiciaires, le jeune greffier de la Cour des Pairs avait une tenue grave et solennelle, dont l’audience lui savait beaucoup de gré, et dont l’assistance paraissait satisfaite. Les devoirs imposés au greffier de la Cour des Pairs étaient d’ailleurs quelquefois pénibles et avaient leur face dramatique. C’est en l’absence des accusés qu’était prononcé l’arrêt des juges de la haute juridiction politique, et le greffier était commis pour faire au condamné la lecture de sa sentence. Ce fut Cauchy le Lyrique qui lut au maréchal Ney son arrêt de mort. »
Avec le premier Cauchy, un secrétaire-rédacteur adjoint avait été élu en l’an VIII. Il avait été annoncé au Tribunat comme Alphonse » Gail « , mais il s’agit en fait d’Alphonse GARY (Toulouse, 1765-1840), qui apparaît comme tel, mais aussi comme trésorier dans l’almanach de l’an XI. En 1806, il fait hommage au Tribunat et au Corps législatif de son ouvrage Essai sur le nouvel équilibre de l’Europe, et est qualifié à cette occasion d’ancien trésorier du Sénat et ancien officier de l’état-major général (AP 9, pp. 161 et 195). Fils de capitoul. Son frère aîné, le baron Alexandre-Gaspard, fut membre du Tribunat, préfet, procureur général, et épousa comme lui une fille de (futur) pair de France.
Eugène Cauchy eut pour adjoint, à partir de la fin 1831, Léon Dufresne de LA CHAUVINIÈRE (1805-1868), déjà employé au cabinet du grand référendaire, auditeur puis (1842) maître des requêtes au Conseil d’État. Il officia lors des procès de Fieschi, de Louis-Napoléon, etc.
Sénat impérial (1852-1870)
Le « bureau des procès-verbaux » ne compte que deux membres de mars 1852 à 1860, si l’on en croit l’Almanach impérial – un secrétaire-rédacteur et son adjoint. À partir de 1861, le premier, Hippolyte Prévost, devient chef des « procès-verbaux et [de la] sténographie », tandis que le second, Eugène Ferré, est chef du « service des comptes rendus ». En 1863 apparaissent Chevallier-Rufigny, Couailhac, Michelant et Félix Prévost (ce dernier devenant secrétaire du service dans l’Almanach de 1867) ; en 1867 arrivent Matagrin et Tournier. Lescure est mentionné en 1870, d’emblée adjoint.
Hippolyte PRÉVOST
(Toulouse, 1808 – Paris, 1873) avait commencé d’apprendre le violon et le droit dans sa ville natale quand il partit pour Paris, en 1827, mais il avait en outre déjà publié une théorie de la sténographie, inspirée de Bertin. En 1828, il fut admis au Messager des chambres, puis en 1830 à la rédaction du Moniteur et chargé de diriger la publication officielle des Chambres. Appelé en 1848 à organiser le service sténographique de la Constituante, puis de la Législative, il entra en 1852 dans l’administration du Sénat, en qualité de secrétaire-rédacteur en chef des procès-verbaux des séances.
Sa théorie de la sténographie (Nouveau Manuel Complet de Sténographie ou Art de continuer le mot à écrire – ou Art d’écrire aussi vite que l’on parle) en était à la sixième édition en 1862, mais il a également écrit une Sténographie musicale, ou art de suivre l’exécution musicale en écrivant (1833). Il a tenu la rubrique de la critique musicale dans la Revue des théâtres et, de 1837 à 1853, dans le Journal du Commerce et le Moniteur ; puis dans d’autres journaux sous les pseudonymes de P. Crocius ou de Paul Hollens. A publié en 1853 un Album des compositions de la reine Hortense. Il a également recueilli un grand nombre de cours et de leçons donnés à la Sorbonne ou au Collège de France.
(Sources : Fétis, Biographie universelle des musiciens ; Vapereau. Voir Hugo Coniez, Écrire la démocratie, L’Harmattan, 2008, pages 124-125 notamment, pour des compléments).
« Le service sténographique de l’Assemblée était fait à l’extérieur par quatre commissionnaires attachés au Moniteur, et chargés de porter à l’imprimerie la copie des sténographes et de rapporter les épreuves au palais de l’Assemblée où M. Hippolyte Prévost les corrigeait. M. Hippolyte Prévost, chef du service sténographique, et logé en cette qualité au palais législatif, était en même temps rédacteur du feuilleton musical du Moniteur. Le 1er décembre il était allé voir à l’Opéra-Comique la première représentation d’une pièce nouvelle, il ne rentra qu’après minuit. Le quatrième commissionnaire du Moniteur l’attendait avec l’épreuve du dernier feuillet de la séance. M. Prévost corrigea l’épreuve, et le commissionnaire s’en alla. Il était en ce moment-là un peu plus d’une heure, la tranquillité était profonde ; excepté la garde, tout dormait dans le palais. » Victor HUGO, Histoire d’un crime.
Eugène FERRÉ
(Cherbourg, 1813 – Cherbourg, 1875) Ancien sténographe du Moniteur, il est en 1860 chargé d’organiser le nouveau service des comptes rendus et en sera récompensé en juillet 1869 par sa nomination comme secrétaire général.
Henri CHEVALLIER-RUFIGNY
(Poitiers, 1828-1902), licencié en droit, attaché au préfet de la Vienne, Janin, puis, en 1855, secrétaire particulier du Président du Sénat Troplong, et chargé de plusieurs missions par le ministère de l’intérieur. Devint, en sus de ses fonctions au cabinet du président, secrétaire-rédacteur en 1864, chef adjoint en 1865, chef en 1870. Après la chute de l’Empire, occupe des fonctions dirigeantes dans la compagnie de navigation Valery, puis à la Société marseillaise de crédit dont il défend les intérêts en Tunisie (affaire d’Enfida en 1880-81). Malade, il se retira à Poitiers vers 1890. Tertiaire de saint François, il s’occupa d’y développer les sociétés de Saint Vincent de Paul.
(Sources : Beauchet-Filleau, Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou ; Semaine religieuse de Poitiers)
Louis COUAILHAC
 (Lille, 1810 – Paris, 1885) – portrait par Nadar, d’après un catalogue Tajan. « Après de bonnes études au collège Henri IV, il occupa une chaire de grammaire à Lyon, où il publia un recueil de nouvelles, Les sept contes en l’air (1832). » Quitta l’enseignement l’année suivante pour tenter sa chance à Paris, comme auteur. « C’est au théâtre, où il a donné plus de 60 pièces qu’il a le mieux réussi : Brutus (1843), Le roi des goguettes (1844), la Cuisinière mariée (1845), etc. Parmi ses romans, genre qu’il a abandonné assez vite, nous citerons : Avant l’orgie (1836, 2 vol.) ; Pitié pour elle (1837, 2 vol.) ; une Fleur au soleil (1838, 2 vol.) ; les Mères d’actrices (1843, 3 vol.), qui se distinguent par une peinture très-vive des mœurs théâtrales; le Comte de Mauléon, etc. M. Couailhac a pris une part active à diverses publications littéraires, telles que Les Français peints par eux-mêmes, Les Étrangers à Paris, Le Jardin des plantes ; enfin l’on a de lui un petit livre de caractères, le La Bruyère charivarique (1842), et quelques bonnes physiologies (l’Homme marié et le Jour de l’an), etc.
(Lille, 1810 – Paris, 1885) – portrait par Nadar, d’après un catalogue Tajan. « Après de bonnes études au collège Henri IV, il occupa une chaire de grammaire à Lyon, où il publia un recueil de nouvelles, Les sept contes en l’air (1832). » Quitta l’enseignement l’année suivante pour tenter sa chance à Paris, comme auteur. « C’est au théâtre, où il a donné plus de 60 pièces qu’il a le mieux réussi : Brutus (1843), Le roi des goguettes (1844), la Cuisinière mariée (1845), etc. Parmi ses romans, genre qu’il a abandonné assez vite, nous citerons : Avant l’orgie (1836, 2 vol.) ; Pitié pour elle (1837, 2 vol.) ; une Fleur au soleil (1838, 2 vol.) ; les Mères d’actrices (1843, 3 vol.), qui se distinguent par une peinture très-vive des mœurs théâtrales; le Comte de Mauléon, etc. M. Couailhac a pris une part active à diverses publications littéraires, telles que Les Français peints par eux-mêmes, Les Étrangers à Paris, Le Jardin des plantes ; enfin l’on a de lui un petit livre de caractères, le La Bruyère charivarique (1842), et quelques bonnes physiologies (l’Homme marié et le Jour de l’an), etc.
M. Couailhac est aussi un des vétérans de la presse parisienne, à laquelle il a longtemps fourni des faits divers, des feuilletons, des articles de circonstance, des articles politiques, des comptes rendus, etc. De 1833 à 1848, il a presque toujours travaillé dans les journaux de l’opposition : le Temps, le Messager, le Courrier-Français, le Corsaire, le Charivari, la Caricature, le Droit. Entré à la Patrie en 1847, il suivit jusqu’au coup d’État les variations politiques de cette feuille, et fut chargé, après 1862, de la rédaction de la Normandie, à Rouen, et du Nord, à Lille, fondés l’un et l’autre pour soutenir le gouvernement. Aujourd’hui, il écrit pour les théâtres de vaudeville. Il a signé dans la Presse jusqu’en 1856 une intéressante correspondance sur les affaires d’Espagne, dont les matériaux lui étaient envoyés de Madrid par son frère, Victor Couailhac. De 1855 à 1861, il fut correspondant de L’Indépendance belge et de l’Écho du Pacifique, puis devint secrétaire-rédacteur au Sénat [ne figure pas dans l’almanach de 1870]. Il prit les fonctions de chef adjoint du service du compte rendu analytique lors de la création de la nouvelle Chambre haute (1876). »
Son frère, également auteur de pièces, était en outre acteur sous le nom d’Eugène Fradelle, et sténographe. « Ils ont vécu du métier et du sacerdoce ; du journalisme et du théâtre. L’un faisait le compte rendu des chambres quand l’autre confectionnait des vaudevilles ; quand l’un reprenait la plume du vaudevilliste, l’autre reprenait la plume du sténographe ; tous deux ont été un peu acteurs, un peu journalistes, un peu dramaturges. L’un est décoré, l’autre aspire à l’être. Ils le seront tous les deux… au retour des chambres. » (Théodore Labourieu, Le petit Vapereau, 1870, p. 85)
À la liste des vaudevilles de Couailhac, on peut ajouter : Plock le pêcheur (1838), L’affaire Chaumontel (1848) ; L’ange du rez-de-chaussée (1850), Arrêtons les frais ! (1861), Les bonnes (1864)… À la liste des physiologies, toutes publiées en 1841-42, celles du Jardin des plantes, du théâtre, du célibataire (cette dernière avec Henry Monnier). D’autre part, on lui attribue La révolte de Lyon en 1834 ou la fille du prolétaire, roman populaire anonyme de 1835. A collaboré avec Dumas sur Une fille du Régent.
Un des fondateurs de la Société des gens de lettres et auteurs dramatiques (1838)
« COUAILHAC (L.) — Voltigeur de la presse légère, du théâtre égrillard et du roman frivole. » (Monselet, La lorgnette littéraire, 1859) ; « L. Couailhac, ce collaborateur de tant de petits journaux, cet ex-sténographe de la Chambre des Députés, aujourd’hui correspondant de certains grands journaux… » (F. Maillard, Histoire anecdotique et critique de la presse parisienne, 1859)
En 1839, il avait publié une Biographie politique et parlementaire des députés.
Louis MICHELANT
(Reims, 1814 – Versailles, 1897) se lança de bonne heure dans le journalisme. Il devint l’un des rédacteurs du Journal des économistes et du Dictionnaire général du commerce. Membre de la société d’économie politique. SR du Sénat en 1864. Outre une collaboration importante à la Revue des théâtres, à la Revue de France, au Journal de l’instruction publique, à la Revue de l’architecture, au National, à la Patrie, au Capitole, à la France (de 1871 à 1877), il a publié en volumes : La morale en images (1842-43) ; Les faits mémorables de l’Histoire de France (1843) ; un roman tiré des Chroniques de Canongate de Walter Scott, La fille du chirurgien (1853) ; des Contes (1856), etc.
Si l’on en croit les almanachs, il aurait pris sa retraite au plus tôt en 1887 (à 73 ans ?!) et au plus tard en 1890. (Sources : Vapereau et Lermina).
Félix PRÉVOST
Mort d’apoplexie en février 1870, à 48 ans, alors qu’il était (ou n’était plus ?) secrétaire-rédacteur.
Amédée MATAGRIN
(Tarare, 1823 – 1876) était un journaliste impérialiste (puis bonapartiste). Avocat, docteur en droit (Dijon, 1846), on le retrouve à Périgueux où il dirige Le Périgord. C’est à cette époque qu’il publie une biographie de Bernard Palissy (1856) et La noblesse du Périgord en 1789 (1857), ainsi qu’une brochure de 32 pages intitulée : De la nécessité d’une presse gouvernementale (1862). Il exerce ensuite ses talents à Bordeaux, au Journal de Bordeaux, puis à Angoulême, au Charentais (vers 1866). Reçu secrétaire-rédacteur au Sénat, il est révoqué pour insuffisance au plus tard au début de 1869 (P. Laharie, Contrôle de la presse, de la librairie et du colportage sous le Second Empire, Archives nationales, 1995). Il finit secrétaire de rédaction au Constitutionnel qui commençait sa décadence. Voir Le Constitutionnel du 26 mars 1876.
Jules TOURNIER
(Douai, 1829 ? – ?). Archiviste de l’Assistance publique de 1864 à 1866, il avait entamé l’inventaire des archives des hôpitaux de Paris et ce tome I est devenu particulièrement précieux après l’incendie de 1871 (Henri Bordier et Léon Brièle, Les archives hospitalières de Paris, 1877, p. 5).
Comme dans l’autre chambre, le recrutement a dû se faire par concours à la fin de l’Empire, mais le principe souffrait des transgressions, si l’on en juge par cette protestation parue dans La Cloche du 7 août 1869 – probablement à propos du concours organisé pour remplacer Matagrin :
« Une place de secrétaire-rédacteur au Sénat était vacante ; un concours était ouvert.
Mais M. Rouher n’est pas président pour respecter les usages, ni Auvergnat pour obéir aux convenances. Il fit clore le concours, et nomma, non pas simple secrétaire-rédacteur, mais sous-chef, un sien parent et co-Auvergnat, M. de Lescure, l’historien des maîtresses de nos rois.
Il est vrai qu’il est aussi l’historien de Marie Antoinette, et que c’est là une plus puissante recommandation à… Trianon, que d’être, comme M. Haussmann, petit-fils d’un conventionnel.
M. Mathurin de Lescure a écrit à la Gazette de France. Il n’était pas fâché alors de passer pour parent du général vendéen avec lequel il n’a de commun que le nom. »
Pour la biographie de Lescure, voir ci-après.
En 1870, on trouve les noms de deux nouveaux, GONDARD et BOISSIÈRE, ainsi que celui d’un secrétaire du service, GONDOIN. Gondard était depuis 1866 secrétaire particulier du premier vice-président Paul Boudet, comme Chevallier-Rufigny l’était du président. Au cours des années précédentes, un architecte adjoint du Sénat portait le nom de Gondoin.
Le Sénat de la IIIe République (1875-1940)
Le Figaro du 29 mars 1876 : « Le Sénat vient de choisir ses secrétaires-rédacteurs. Depuis la nomination de la commission des Trente, du temps de M. Thiers, bien avant que l’existence d’un Sénat fût assurée, il y avait deux cents demandes pour ce poste. Mais, en somme, une douzaine de postulants seulement étaient regardés comme sérieux. // Les places ont été données, partie à d’anciens secrétaires au Sénat, partie à des personnes choisies un peu d’après les recommandations des divers partis, ainsi qu’il convient au vrai parlementarisme. // Ont été nommés : chef des secrétaires-rédacteurs, M. de Lescure ; rédacteurs, MM. Couailhac, Henry de Lapommeraye, Charles Simon, Eugène Ceyras, R. Ganneron, Perron, Audemar, Gandoin, Chauveau et Octave Lacroix. »
L’almanach de 1876 donne une liste assez différente : Lescure, chef ; Couailhac, chef adjoint. Secrétaires-rédacteurs : Michelant, de Lapommeraye, Lacroix, Charles Simon, Peyron, Ganneron. Secrétaire-rédacteur adjoint : Marion. Ce dernier est titularisé l’année suivante, mais ne figure plus dans l’almanach de 1879, où apparaissent Audemar et Ceyras. Dans celui de 1880, arrive un autre SR adjoint, Bertrand, lui aussi titularisé l’année suivante.
Dans l’almanach de 1886, Couailhac a disparu, remplacé par Lapommeraye (et non par Michelant). Audemar non plus n’est plus mentionné. En dernière position, on trouve (après Bertrand), Bonsergent et N. En 1887-88, ce poste vacant est occupé par Grandjean.
En 1884, l’Univers illustré, sous la signature de Gérôme (pseudonyme collectif, mais souvent utilisé à cette époque par… Anatole France), publie un portrait d’Alfred Bonsergent qu’on lira plus loin, et signale en passant que « cette administration du Sénat contient un assez grand nombre d’écrivains de valeur. Il suffit de signaler, parmi les secrétaires-rédacteurs, le chef même de M. Alfred Bonsergent, M. de Lescure, dont l’érudition spirituelle se promène si agréablement à travers le XVIIIe siècle et qui a consacré à Rivarol une magistrale étude – à la bibliothèque, MM. Leconte de Lisle [à qui Coppée avait abandonné sa place], Louis Ratisbonne et Anatole France ; aux archives, M. Louis Favre, à qui l’on doit deux ouvrages précieux, l’un sur le chancelier Pasquier, l’autre sur le palais du Luxembourg ; au matériel, M. Charles Grandjean ; aux procès-verbaux, MM. Octave Lacroix et Henri Welschinger ; au secrétariat de la présidence, M. Sorel, qui fait des travaux considérables sur la diplomatie et cache ses petits vers… » Paul Masson (Intermédiaire des chercheurs et des curieux, 1888) ajoutera à la liste Albert Mérat et les deux autres bibliothécaires, Charles-Edmond (Choiecki) et Lacaussade, pour démontrer que le Sénat est « l’administration la plus riche en gens de lettres ».
Adophe-Mathurin de LESCURE
 (Bretenoux, Lot, 1833 – Clamart, 1892), historien et littérateur, secrétaire au ministère d’État sous Rouher (1865-68), puis SR au Sénat, chef adjoint du service en 1870 (voir supra), chef de 1876 à 1892. Probablement le plus prolifique de tous les secrétaires-rédacteurs, avec Ernest Daudet. Dans ses ouvrages d’histoire dominent, à côté des publications de correspondances ou de mémoires, les biographies de femmes et les « chroniques d’alcôve ». Son époque de prédilection est très nettement le XVIIIe siècle, entre la Régence et Marie-Antoinette.
(Bretenoux, Lot, 1833 – Clamart, 1892), historien et littérateur, secrétaire au ministère d’État sous Rouher (1865-68), puis SR au Sénat, chef adjoint du service en 1870 (voir supra), chef de 1876 à 1892. Probablement le plus prolifique de tous les secrétaires-rédacteurs, avec Ernest Daudet. Dans ses ouvrages d’histoire dominent, à côté des publications de correspondances ou de mémoires, les biographies de femmes et les « chroniques d’alcôve ». Son époque de prédilection est très nettement le XVIIIe siècle, entre la Régence et Marie-Antoinette.
Il aurait débuté en 1857 chez Poulet-Malassis, publiant dans la Gazette de France (royaliste) des comptes rendus des Fleurs du Mal et des Paradis artificiels édités par celui-ci. Tous deux partageaient un goût prononcé pour les curiosa mais, note Claude Pichois, Malassis aurait été indisposé par les prétentions de son collaborateur à jouer les directeurs de collection et la relation cessa en 1864. Lescure entra chez Rouher l’année suivante.
Un libraire actuel (Librairie du Manoir de Pron) indique : « [Ce] royaliste se fit un devoir de rééditer les mémoires de la Duchesse d’Angoulême, Sénac de Meilhan, des études sur Marie-Antoinette… » On essaiera de citer dans l’ordre chronologique, pour donner une idée du rythme de production : Les maîtresses du Régent (1857), Les philippiques de la Grange-Chastel (1857), La vraie Marie-Antoinette (1858), Eux et elles, histoire d’un scandale (1858, à propos de G. Sand, Musset et Louise Colet), Les confessions de l’abbesse de Chelles, fille du Régent (1858 ou 1863) ; Les autographes et le goût des autographes en France et à l’étranger (1859 ou 1865) ; La princesse de Lamballe (1864) ; Les amours de Henri IV (1864 ou 1865) ; Correspondance de la marquise du Deffand (1865) ; Les amours de François Ier (1866) ; Marie-Antoinette et sa famille (1866) ; Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour et la ville, (2 vol., 1866), Jeanne d’Arc, l’héroïne de la France (1866) ; Lord Byron, histoire d’un homme (1866) ; Le palais de Trianon (1867) ; Marie Stuart (1868) ; Mémoires du marquis de Boissy (1869) ; Les nouveaux mémoires du maréchal duc de Richelieu (1870-73) ; Henri IV (1873) ; François Ier (1878) ; Éloge de Marivaux (1880) ; La société française pendant la révolution : L’amour sous la Terreur (1881 ou 82) ; Les femmes philosophes (1881) ; Les mères illustres (1882) ; Les grandes épouses (1883 ou 84) ; Rivarol et la société française pendant la Révolution et l’émigration (1883 ou 84) ; Études sur Beaumarchais (1886). Entre 1871 et 1881, il a publié neuf volumes de la collection Mémoires relatifs à l’histoire de France (sur la guerre de Vendée, sur l’émigration, sur les comités de salut public et de sûreté générale, et sur les prisons, sur les assemblées parlementaires de la Révolution, ainsi que les mémoires de Brissot, de Duclos, etc.) ; a aussi écrit sur Mme Mère, sur la duchesse de Lauzun…
Mais il faut aussi intercaler quelques romans (Les chevaliers de la mouche à miel, 1870 ; La dragonne, 1871 ; Le cadet de Gascogne, Le château de Barbe-Bleue, 1873 ; Mademoiselle de Cagliostro, 1878 ; Le démon des Montchevreuil, 1880 ; Où est la femme ?, 1884) et des études littéraires : Le monde enchanté, histoire des fées et de la féerie (1881) ; François Coppée, l’homme et l’œuvre (1889) ; Bernardin de Saint-Pierre (1892), Joseph de Maistre et sa famille (?). Lescure a également publié des éditions du théâtre de Marivaux, de Manon Lescaut, du Comte de Comminges, des Mémoires et Contes d’Hamilton, de la Vie de Marianne de Marivaux, de la Princesse de Clèves, des Mémoires de Mme de Staël, des lettres d’Henri IV, des oeuvres choisies de Chamfort, de Rivarol, de Saint-Evremond, etc., etc.
(Sources : Gubernatis, Dictionnaire international des écrivains du jour ; Catalogue de la librairie fr.)
Louis COUAILHAC
voir supra. Chef adjoint jusqu’à ses soixante-dix ans (1880) probablement.
Henri (Berdalle) de LAPOMMERAYE
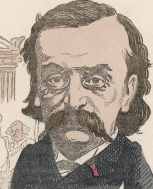 (Rouen, 1839 – 1891) – vu ici par Henri Demare, pour Les hommes d’aujourd’hui, dans les années 1880. Fils d’un imprimeur-graveur normand, il renonça à préparer Normale pour raisons de santé et « entra à l’Hôtel de ville de Paris, où il remplaça M. Henri Rochefort dans la vérification des comptes ; en même temps, il suivit les cours de la faculté de droit, et se fit recevoir avocat. Menant de front les études administratives et littéraires, il commença, en 1867, à faire des cours gratuits d’enseignement public à l’Association polytechnique, et fonda deux sections à Sceaux, où il professa une fois par semaine le cours de littérature. Vers cette époque, il débuta au théâtre de l’Athénée par une conférence qu’on le pria de répéter. M. Ballande lui demanda, en 1869, son concours pour ses Matinées littéraires de la Gaîté, et il fut avec MM. Legouvé, Sarcey, etc. l’un des conférenciers habituels préférés du public. Son précoce talent l’avait fait remarquer de M. Ferdinand Barrot [grand référendaire du Sénat], qui le choisit, en 1865, pour la réorganisation du service des pétitions au Sénat. Il s’occupa alors de journalisme, et fit, dans la Petite Presse, sous le pseudonyme de Henri d’Alleber, un article quotidien intitulé Un Conseil par jour, dont la série a formé par la suite un volume. Il organisa, au théâtre de Cluny, à la mode anglaise, des lectures publiques dont la société des gens de lettres prit ensuite la direction. En récompense, il fut nommé membre de la société, puis l’un des vice-présidents de son comité.
(Rouen, 1839 – 1891) – vu ici par Henri Demare, pour Les hommes d’aujourd’hui, dans les années 1880. Fils d’un imprimeur-graveur normand, il renonça à préparer Normale pour raisons de santé et « entra à l’Hôtel de ville de Paris, où il remplaça M. Henri Rochefort dans la vérification des comptes ; en même temps, il suivit les cours de la faculté de droit, et se fit recevoir avocat. Menant de front les études administratives et littéraires, il commença, en 1867, à faire des cours gratuits d’enseignement public à l’Association polytechnique, et fonda deux sections à Sceaux, où il professa une fois par semaine le cours de littérature. Vers cette époque, il débuta au théâtre de l’Athénée par une conférence qu’on le pria de répéter. M. Ballande lui demanda, en 1869, son concours pour ses Matinées littéraires de la Gaîté, et il fut avec MM. Legouvé, Sarcey, etc. l’un des conférenciers habituels préférés du public. Son précoce talent l’avait fait remarquer de M. Ferdinand Barrot [grand référendaire du Sénat], qui le choisit, en 1865, pour la réorganisation du service des pétitions au Sénat. Il s’occupa alors de journalisme, et fit, dans la Petite Presse, sous le pseudonyme de Henri d’Alleber, un article quotidien intitulé Un Conseil par jour, dont la série a formé par la suite un volume. Il organisa, au théâtre de Cluny, à la mode anglaise, des lectures publiques dont la société des gens de lettres prit ensuite la direction. En récompense, il fut nommé membre de la société, puis l’un des vice-présidents de son comité.
La guerre franco-allemande de 1870 vint fournir à l’activité de M. de Lapommeraye un nouvel aliment. Engagé comme volontaire dans les compagnies de marche de la garde nationale, il fut nommé lieutenant. Les devoirs militaires ne l’empêchèrent pas de se dévouer à toutes les oeuvres de bienfaisance pour lesquelles on réclamait le concours de sa parole éloquente et sympathique. Pendant les longs mois du siège, il fit des conférences au bénéfice des ambulances, des blessés, pour le travail des femmes, etc. (…) Après la Commune, la connaissance que possède M. de Lapommeraye des choses du théâtre le fit entrer au Bien public. Il ne tarda pas à s’y faire remarquer, et à prendre, grâce à ses aperçus ingénieux et fins, son style élégant et facile, son agréable érudition, une des meilleures places parmi nos critiques de théâtre contemporains.
(Il) est membre titulaire de la Société polytechnique, ainsi que de plusieurs autres sociétés savantes. (…) Il a publié : La société des secours mutuels (1867), Les invalides du travail (1868), L’art d’être heureux (1868), Un conseil par jour (1870), Les jeunes (1872). » (Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel).
En 1874, nous apprend Vapereau, il « fut appelé par M. de Girardin à la France pour rédiger les comptes rendus de théâtre. Il créa la même année le « feuilleton parlé », causerie hebdomadaire qui eut lieu pendant quatre années » boulevard des Capucines. Il interrompit en effet ces conférences, après la centième, quand il fut nommé professeur d’histoire et de littérature dramatiques au Conservatoire, en 1878. Ses dernières publications, rompant avec les préoccupations sociales des précédentes, témoignent de la place prééminente qu’occupe désormais le théâtre dans son activité extra-administrative : Histoire du début d’Alexandre Dumas fils au théâtre (1872) ; Les amours de Molière (1873), Molière et Bossuet (1877) et une comédie en un acte, La critique de Francillon (1877 également).
Mirbeau moquait ces « groupes bien pensants où trône M. Sarcey et au-dessus desquels flottent comme un drapeau les cheveux de M. Lapommeraye » mais en général, du critique dramatique (qui exerça aussi ses talents au Paris), on louait plutôt l’indulgence. En 1910, dans Le Temps, Adolphe Buisson rappelait le souvenir de « l’écrivain discret et aimable » qui avait créé les feuilletons parlés : « Je revois la tête populaire et chevelue d’Henry de Lapommeraye, son lorgnon de myope planté sur un bec d’aigle, au-dessus d’une moustache à la Vercingétorix. En dépit de ce profil batailleur, c’était le plus pacifique des hommes. Tout le monde l’aimait. Les auteurs prisaient sa mansuétude ; les comédiens goûtaient ses ménagements ; ses confrères rendaient hommage à sa courtoisie. Quelquefois, on s’étonnait de l’inaltérable douceur de sa critique ; mais si cette bienveillance semblait un peu molle, on la savait désintéressée. Lapommeraye était bon, inexorablement bon, incapable d’écrire une ligne cruelle ou dure (…) On le lisait peu. Il en souffrait. Et c’est alors qu’il eut l’idée ingénieuse et charmante, en même temps qu’il publiait son feuilleton théâtral, de le parler. Sa voix sonore emplissait la petite salle du boulevard des Capucines… Chaque orateur avait son jour, Lapommeraye le lundi, Sarcey le jeudi, Flammarion le samedi. Et c’étaient tour à tour l’envolée des périodes grandiloquentes, la familiarité du bon sens malicieux, les chevauchées lyriques à travers le ciel… »
Il était entré au compte rendu analytique en 1876 et en devint chef adjoint en 1885. Il mourut à l’approche de Noël 1892, d’une mauvaise grippe attrapée au Père-Lachaise, à l’enterrement d’Alphand.
Octave LACROIX (de Crespel)

(Égletons, 1827- 1901). Sorti du collège de Juilly, ayant comme d’autres abandonné ses études de droit pour la littérature, il obtient le patronage de Mérimée et de Sainte-Beuve, qui le considère comme son « filleul littéraire et poétique » et en fait son secrétaire en 1851, pour trois ou quatre ans. Il rédige ensuite « quelques feuilles départementales officieuses à Rouen, à Orléans et à Bordeaux ». De retour à Paris, il donne des chroniques parisiennes à L’Europe de Francfort (1863-64), sous le titre « Lettres du spectateur » qu’il reprend lorsqu’il entre au Moniteur, en 1864. « Sous le pseudonyme de Gabriel de Lineuil, M. Octave Lacroix a donné des articles à la Vogue parisienne, et surtout au journal l’Artiste, où il a encore signé Jacques d’Arnay et Jacques de Soudeilles. Il a aussi écrit sous le nom de Noll à l’ancien Gaulois, et sous ceux de Old Laertes et de Paul Sic au Moniteur. Sous la rubrique Lettres d’un spectateur, il a rédigé beaucoup d’articles et de chroniques à l’Europe et au Moniteur du soir. » (Dictionnaire des pseudonymes de G. d’Heyll). « Journaliste, [Octave Lacroix] a donné au Moniteur, au Pays et à La Revue Française un grand nombre d’articles de critique française et étrangère, qui paraîtront prochainement en volume. Ainsi, au Moniteur, des articles sur George Sand, Victor de Laprade, Casimir Delavigne, Molière jeune, Théophile Lavallée, les poètes de 1853, Charlotte Aikermann et le théâtre allemand au XVIIIe siècle, à propos d’un roman d’Otto Müller, – travail qui a été traduit en allemand ; au Pays, des articles sur Henri VIII d’Angleterre ; – à la Revue Française des chroniques littéraires, des études fort remarquables sur Giacomo Leopardi, Lope de Vega, Mme de Girardin, etc., etc. – Il a fait pendant quelque temps un « Courrier de Paris » hebdomadaire au journal Le Courrier de Paris. » (Firmin Maillard, Histoire anecdotique et critique de la presse parisienne, 1859).
En 1872, Lacroix entre au Journal officiel, toujours comme comme critique d’art -, produisant l’année suivante le Rapport officiel sur l’Exposition des Beaux-Arts et des arts industriels à Londres. En 1876, il entre donc au Sénat comme secrétaire-rédacteur.
C’est un des rares poètes qu’auront compté les deux comptes rendus analytiques. Ses recueils se nomment : Chansons d’avril (1851), Lointains et Retours (1890), Les heures errantes (1891), mais il a aussi donné des comédies en vers : L’amour et son train (Comédie française, 1855) et, avec Welschinger, chef du bureau des procès-verbaux, La fille de l’orfèvre (d’après la ballade de Uhland, 1884). On lui doit aussi L’école buissonnière, fantaisies et pensées (1854), Du culte de la Vierge au point de vue de la poétique religieuse (1858) et Quelques maîtres étrangers et français, études littéraires (Boccace, Rabelais, Thomas More, Lope de Vega…, 1891), ainsi qu’une édition du Myosotis d’Hégésippe Moreau (1851). Il avait appris, en même temps que l’italien, l’espagnol, et son œuvre s’en ressent souvent (Padre Antonio, recueil de nouvelles, 1865), mais surtout, il avait fait du Pays basque – de Ciboure précisément – sa patrie d’adoption, d’où Voyage artistique au Pays basque (1883 ?) et Euskal Erria, à mes amis du Pays basque (poésies, 1885). Son collègue au Sénat, le bibliothécaire Louis Ratisbonne, en plaisanta en mobilisant toutes les rimes en -asque (cité par la Gazette anecdotique, 1887) :
| Je m’appelle Octave Lacroix, Toujours jeune, léger, fantasque, Toujours poète ! J’ai la croix, Et je suis Basque.Sur ma naissance on s’est trompé : Je ne sais pas dans quelle vasque Pour mon baptême on m’a trempé, Mais je suis Basque.Si l’indigène, à Monaco, Se fait appeler Monégasque, Un Limousin peut tout de go Se dire Basque. |
J’ai de l’œil, du nez et des dents ; Les ans n’ont pas atteint mon masque Ni détendu mes nerfs ardents, Des nerfs de Basque.L’amour est mon mignon péché… S’il m’a fait faire quelque frasque, Je ne suis pas un débauché, Mais un bon Basque.Les dames qui m’ont distingué Ne m’auront jamais trouvé flasque ; Aussi comme un coq je suis gai, Comme un coq basque. |
Dans la vie où je vais rêvant, Je ne crains aucune bourrasque : Jamais ne souffle un mauvais vent Au pays basque.Lorsque la mort, faisant son miel, Viendra me tirer par la basque, Gaîment je la suivrai… ; – le Ciel Doit être basque.Et je n’aurai rien qu’une peur, C’est que saint Pierre me démasque Et ne dise : « C’est un farceur ! Il n’est pas Basque. » |
En 1859, Firmin Maillard (op. cit.) relevait déjà que Lacroix « recherch[ait] beaucoup la société des femmes, les aimant, les adorant – veux-je dire – toutes ». Il ajoutait : « Une certaine distinction sous une enveloppe d’ancien séminariste ; – parole facile, agréable, – un peu onctueuse, benoîtement maligne ; ne lançant l’épigramme qu’après l’avoir dûment entourée des langes académiques dans lesquels MM. P. Mérimée et Sainte-Beuve l’ont élevé… », mais précisait : « son vers est souple, élégant, facile ».
Charles(-Eugène) SIMON
 (1850-1910) était le fils cadet de Jules Simon. Il « entra dans un bataillon de marche de la garde nationale lors de la guerre [de 1870], y fut nommé sous-lieutenant, et prit part au combat de Montretout. Secrétaire de son père au Ministère de l’instruction publique en 1870, il devint chef de son cabinet au Ministère de l’intérieur en 1876. Nommé, au concours, secrétaire-rédacteur du Sénat en 1875, il est devenu chef de ce service [en 1892, à la mort de Lapommeraye.] Candidat républicain aux élections législatives du 14 octobre 1877, dans la 1re circonscription de Castres, il échoua avec 7 356 voix, contre M. Combes, député monarchiste sortant, qui en obtenait 9 780. L’élection de ce dernier ayant été invalidée, il se représenta, le 3 mars 1878, et n’obtint encore que 7 444 voix contre 8 606 recueillies par son adversaire. » (Vapereau).
(1850-1910) était le fils cadet de Jules Simon. Il « entra dans un bataillon de marche de la garde nationale lors de la guerre [de 1870], y fut nommé sous-lieutenant, et prit part au combat de Montretout. Secrétaire de son père au Ministère de l’instruction publique en 1870, il devint chef de son cabinet au Ministère de l’intérieur en 1876. Nommé, au concours, secrétaire-rédacteur du Sénat en 1875, il est devenu chef de ce service [en 1892, à la mort de Lapommeraye.] Candidat républicain aux élections législatives du 14 octobre 1877, dans la 1re circonscription de Castres, il échoua avec 7 356 voix, contre M. Combes, député monarchiste sortant, qui en obtenait 9 780. L’élection de ce dernier ayant été invalidée, il se représenta, le 3 mars 1878, et n’obtint encore que 7 444 voix contre 8 606 recueillies par son adversaire. » (Vapereau).
Membre du conseil de l’Alliance républicaine, il semble avoir tenté de se faire élire à la Chambre jusqu’en 1889. Mais Charles Simon était également homme de lettres. Il collabora au journal lillois Le petit Nord, fondé en 1878 par son frère aîné Gustave – c’est à cette époque qu’il serait entré en possession du masque mortuaire de Robespierre, dont il décora son bureau au Sénat (selon la légende, c’est Palloy, le démolisseur de la Bastille, qui aurait fait prendre l’empreinte après avoir détourné un moment la tête). Surtout, il est auteur d’au moins quatre pièces : deux écrites en collaboration avec son collègue secrétaire-rédacteur Alfred Bonsergent, Trop heureuse ! (1894) et, jouée à l’Odéon en 1897, Irréguliers ; donnée au Vaudeville, en 1898, Zaza, pièce écrite pour Réjane ; aux Mathurins, en 1910, Doré Sœurs . Il fut secrétaire général du syndicat des auteurs.
« Un petit homme à l’œil vif, au sourire bienveillant, à la démarche rapide ; de parole aisée, plume alerte, esprit et cœur à tout jamais jeunes, sous une barbe prématurément grise (sic), et toujours en mouvement. De-ci, de-là, allant, venant, courant, toujours parlant, toujours écrivant, toujours travaillant, toujours agissant, il a les allures gaies et vives de notre moineau parisien (…) Sérieux d’ailleurs dans des dehors frivoles, menant de front dix affaires… » (Le Figaro).
Léopold PEYRON
(Viens,Vaucluse, 1842 – Cannes, 1924) fut un des piliers de la presse républicaine de Marseille, collaborant jusqu’en 1872 au quotidien L’Égalité, fondé en 1870 par Gaston Crémieux et Maurice Rouvier. Il passa ensuite à La Tribune républicaine (janvier-mars 1873), reprise par Le Petit Provençal. Nommé secrétaire-rédacteur en 1876, il devient chef adjoint en 1892, puis succède à Charles Simon en 1910.
Léo Taxil le donne pour franc-maçon (La France maçonnique, 1888). Selon son dossier de Légion d’honneur (1895), « 15 années de journalisme dans la presse républicaine de Paris et des départements, « fondateur de la section de l’Association polytechnique de Saint-Maur-les-Fossés » et « a fait la campagne de 1870 ».
Émile GANNERON
(Pontoise, 1840 – Paris, 1900), secrétaire-rédacteur de 1876 à sa mort. L’amiral Courbet d’après les papiers de la marine et de la famille (1885) ; L’Irlande depuis son origine jusqu’aux temps présents (Mame, 1888) ; et, chez Colin, des manuels scolaires : L’économie politique (1894), Le droit usuel (1895), ainsi qu’un livre de lecture, Tu seras citoyen (1892).
Germain AUDEMARD
(Tocane-Saint-Apre, Dordogne, 1837 – Paris, 1883) : secrétaire-rédacteur signalé à partir de 1879. Encore une mort précoce. Annonçant son décès, Polyblion le donne pour « collaborateur du Télégraphe et du Soleil dans lequel il traitait sous le pseudonyme de Bernard les questions économiques ». Également rédacteur de l’Association de l’industrie française.
Le Télégraphe, fondé par Auguste Dumont en 1877, a été repris par Louis Jezierski en 1879. Il était commandité par le sénateur Nicolas Claude, filateur vosgien. Après avoir été proche de Thiers, le journal serait passé au service de Freycinet dont Jezierski était le collaborateur. Le Soleil avait été fondé par Moïse Millaud en 1865 pour faire pièce au Figaro ; il avait la réputation de très bien payer ses collaborateurs. Y parurent Les Travailleurs de la mer et des romans de Gaboriau. Classé comme conservateur.
Eugène CEYRAS
(Tulle, 1832 – Clamart, 1892), fils de Henry-Auguste, ancien juge à Tulle et député de 1848, ami de Pierre Leroux et connu pour avoir demandé un million pour les invalides des campagnes. Eugène fut journaliste d’opposition sous l’Empire (le Corsaire, le Nain jaune, le Pilori), plusieurs fois poursuivi, et deux fois enfermé à Sainte-Pélagie (un frère, Charles, mort en 1885, a collaboré au Nain jaune, à l’Europe, au Peuple et aux Droits de l’homme). Un Eugène Ceyras à la barbe rouge est cité dans la bohème qui fréquentait le café du Rat mort, avec Murger et Mérat, et il aurait collaboré au Pilori de Victor Noir. Un abîme le sépare donc du suivant. Pendant le Siège, il s’engagea dans les bataillons de marche et fut blessé à Buzenval.
Émile MARION
n’est pas resté longtemps. La Renaissance, journal lyonnais, annonce sa révocation en ces termes le 23 mai 1879 : « Un sieur Marion, qui fut un piètre journaliste de province, puis factotum de M. Ducros à la préfecture du Rhône, et enfin secrétaire-rédacteur du Sénat, occupe le public de ses réclamations. On a enlevé à ce parvenu de la réaction sa sinécure sénatoriale, et il pousse des cris à fendre tous les cœurs sensibles. C’est au point que des journaux sérieux ont cru devoir expliquer que ledit Marion avait été révoqué, non pour ses opinions intimes, mais pour avoir pris, pendant le 16 mai, une part active à la rédaction du Bulletin des Communes. On fait bien d’honneur à ce mince personnage. Le flux de la réaction l’avait élevé, le reflux l’abaisse. C’est justice, et ce n’est pas trop tôt ! »
Ducros a été un préfet de l’Ordre moral et le Bulletin des Communes était devenu un organe monarchiste (voir notice d‘E. Daudet). Le Gaulois du 18 mai 1879 a publié une lettre dans laquelle le rédacteur en chef de Paris-Journal proteste contre l’expulsion de son « séancier » Marion de la tribune des journalistes de la Chambre. La décision, attribuée à Scheurer-Kestner, suscita de vifs remous au Sénat (démission de deux sénateurs) et dans la presse qui, au delà du point de savoir si Marion était bien l’auteur de l’article attaquant les 363 en 1877, ouvrit un débat sur le devoir de réserve des secrétaires-rédacteurs : avaient-ils le droit d’exprimer des positions politiques, en tant que journalistes ou, comme Charles Simon, en tant que candidats aux élections ?
Marion sera en 1885 le maître d’œuvre d’un Dictionnaire de la bourse, de la banque et des assurances, publié sous le patronage du sénateur Bozérian. Il se déclare alors fondateur de sociétés coopératives de consommation, ancien chef de division à la préfecture du Rhône… et ancien secrétaire-rédacteur du Sénat !
Alphonse BERTRAND
(Tours, 1850 – 1907), qui présidait l’Association artistique et littéraire de Versailles et devint en 1893 adjoint au maire de la ville, a écrit toute une série d’articles sur le château, réunis en volume sous le titre Versailles, ce qu’il est, ce qu’il fut, ce qu’il devrait être (1906). Directeur de la Correspondance républicaine, il avait écrit en 1875 un roman, Marcel (en collab. avec A. N. Lebègue), mais c’est sans doute un péché de jeunesse. Il est surtout connu pour la série : La Chambre de 1889, biographies des 576 députés (1889) ; La chambre de 1893, biographies des 581 députés (1893) ; La Chambre des députés, 1898-1902, biographies des 581 députés (1899) ; Le Sénat de 1894, biographies des 300 sénateurs (1894) avec un supplément, Le Sénat en 1897 (1897). Il est également l’auteur de Ferdinand de Lesseps, sa vie, son œuvre (1887, avec E. Ferrier) ; de L’organisation française, le gouvernement, l’administration ; guide du citoyen et manuel à l’usage des écoles (1882) et de Les origines de la Troisième République, 1871-1876 (posthume, 1910).
1894 : Charles Simon, chef ; Léopold Peyron, chef adjoint ; Michelant, honoraire ; Octave Lacroix, Émile Ganneron, Alphonse Bertrand, Alfred Bonsergent, Charles Grandjean, Émile Monnet, Philippe de Rouvre, Lucien de Sainte-Croix, secrétaires-rédacteurs ; Pierre Maubrac et Émile Delorme, secrétaires-rédacteurs adjoints.
Alfred BONSERGENT
(Ile Maurice, 1848 – Paris, 1900), beau-frère du secrétaire général de la questure Descombes, était commis principal du secrétariat général de la présidence du Sénat quand il a été nommé secrétaire-rédacteur sans passer par un concours, en 1883 – en remplacement d’Audemard. Il a donc écrit en collaboration avec Charles Simon deux pièces en trois actes, Trop heureuse ! (1894) et Irréguliers (1897), mais il s’était déjà lancé dans le théâtre : L’embarras du choix, comédie en un acte en prose (1890), Responsabilité (pièce donnée au Théâtre Moderne pour être jouée par Térésa, 1892), Malgré tout, pièce en un acte (1893). En 1895, il est chargé de la critique dramatique et musicale à la Revue parisienne. On a toutefois l’impression que cette carrière dramatique s’est bornée à ces sept ou huit années. Bonsergent est surtout un auteur de nouvelles puis de romans : Cinq nouvelles (1874), Une muse [et autres nouvelles] (1875), Miette et Broscoco, nouvelles (1881), Madame Caliban, roman (1882), La revanche d’Alcide, nouvelles (1883), Une énigme, roman (1884), Le vétéran, nouvelles (1885), L’oiseau de la mort (1888 ?), Bébelle, roman (1889), Trop tard, roman (1891), La maison du quai planté, roman (Roméo et Juliette à Lannion ! 1892), Monsieur Thérèse (1892), Myosotis, roman contemporain (1896), Cabinet d’affaires (1899).
On n’est peut-être pas exhaustif, mais les arguments ou intrigues dont on a pu prendre connaissance n’incitent pas à de trop grandes recherches. Ainsi L’énigme dont Gérôme fait la publicité dans l’Univers illustré en vantant son romanesque (entendez son refus du naturalisme) raconte l’histoire d’une demoiselle qui se tue après que ses projets de mariage ont été brisés par la ruine de son père. Monsieur Thérèse est une histoire d’adultère. Irréguliers pose le problème de l’union libre, mais assez timidement. Cependant, Bonsergent semble n’avoir pas pris trop au sérieux les histoires qu’il racontait, s’évadant dans des causeries ou des tableaux artistes – mais d’aucuns lui reprochent alors sa « faconde » ou son « laisser-aller ». À propos de ses premières nouvelles, on a aussi parlé de situations indécentes, de « récits échevelés, byroniens, mussettiques »… Bonsergent a aussi payé son tribut à l’institution qui l’employait avec Procédure des débats parlementaires (1878), Comment se fait la loi (1881) et, vraisemblablement, La loi (1890).
Gérôme l’a décrit ainsi : « M. Alfred Bonsergent est un jeune créole de Maurice que vous pouvez voir dans la salle des séances du Sénat chaque fois que siègent les membres de la Chambre haute. Il ressemble beaucoup de sa personne à M. Clemenceau, dont il a les yeux caves et brillants, les pommettes saillantes et la vive allure. (…) Je ne le ferais pas connaître complètement si je ne disais qu’il est grand ami des peintres et des sculpteurs : il les fréquente en forêt comme à la brasserie et il leur dit à l’occasion de salutaires vérités, car c’est un critique d’art fort épris du beau et peu complaisant. »
Sources : Gubernatis, op. cit. ; Catalogue de la librairie française.
Charles GRANDJEAN
(Langres, 1857 – 1933) est sorti premier de sa promotion de l’École des chartes en 1881. Sa thèse, non publiée, portait sur l’organisation municipale de Toulouse au Moyen Âge. La nécrologie de l’archiviste-paléographe (Bibliothèque de l’école des chartes, 1933 -2, p. 414) est apparemment le document le plus substantiel qu’on puisse trouver sur sa carrière : « Nommé membre de l’École française de Rome, il se consacra à l’édition des Registres du pape Benoît XI. De retour à Paris, il entra au Sénat comme rédacteur et y devint chef des secrétaires-rédacteurs chargés du compte rendu. Henri Roujon, directeur des Beaux-Arts, l’adjoignit alors à son administration. Comme inspecteur général des monuments historiques, il prit une part très importante à la sauvegarde du Mont-Saint-Michel, du palais des Papes à Avignon, et fut à Versailles l’un des promoteurs de la réorganisation du Musée historique et de la conservation du palais. D’utiles réformes lui sont dues.
Notre confrère, qui était membre de la Commission des monuments historiques et du Comité des travaux historiques, n’a rien publié, mais il faisait bénéficier ses confrères et ses collaborateurs de son érudition, qui était considérable et variée. Sa curiosité d’esprit en avait fait un spécialiste de l’histoire et des institutions du Consulat et de l’Empire autant qu’il l’avait été des questions italiennes. Ceux qui l’ont connu ont gardé le souvenir de sa bonne grâce, de sa complaisance et de sa courtoisie. » J. C.
Il semble donc que Grandjean ait porté le titre de secrétaire-rédacteur alors même qu’il se trouvait à Rome (1880-81) ! Il est devenu sous-chef, puis aussitôt, du fait de la mort de Charles Simon, chef en 1910, à peu près au moment où, de contrôleur, il devenait inspecteur général des monuments historiques – fonction où la retraite intervenait alors plus tôt qu’au compte rendu analytique. Il était en effet depuis assez longtemps inspecteur honoraire lorsqu’en 1927, atteint par la limite d’âge, il fut remplacé au Sénat par Pierre de Lapommeraye, Laîné devenant chef adjoint.
Émile MONNET
(Niort, 1852 – Paris, 1895), fils d’Alfred, maire de Niort et député puis sénateur des Deux-Sèvres. Secrétaire de la commission d’enquête de l’Assemblée sur les marchés de guerre, présidée par le duc d’Audiffret-Pasquier, il suit celui-ci au Sénat (1876 ?). Est dit attaché à la présidence du Sénat dès 1885, dans les bulletins de la Société de statistique des Deux-Sèvres dont il est un collaborateur actif. Serait devenu secrétaire-rédacteur en 1891 au plus tard. A publié Histoire de l’administration provinciale, départementale et communale en France (1885), Souvenirs d’un Conventionnel (1888) et Archives politiques des Deux-Sèvres, 1789-1889 (en deux volumes, 1889). Malade, il ne survit pas à sa femme.
Philippe (Brunot) de ROUVRE
(Lille, 1846 – 1921). On l’a déjà rencontré à propos de la pièce qu’il fit jouer en 1882 avec son futur collègue de la Chambre Hippolyte Lemaire : un critique (Arnold Mortier, Les Soirées parisiennes, 6) releva alors, comme si le fait ajoutait à leur inexpérience de débutants qui les avait portés au scabreux, que l’un était professeur de mathématiques et l’autre (de Rouvre) fils de général. Le général en question doit être Philippe Brunot de Rouvre (1812-1886), qui avait fait carrière dans la gendarmerie. Quant à l’intrigue de ce Mariage d’André, reposant sur l’adultère d’une femme du monde, elle n’était pas plus indécente que celles de Bonsergent et Simon. Reste que ce coup d’essai semble n’avoir pas eu de suite immédiate, malgré un accueil de la critique somme toute assez indulgent. Les seules autres traces d’une activité littéraire, en dehors des contributions en 1877-78 à La jeune France et au Bon Foyer, journal des familles, sont datées au plus tôt de 1899 : « livret » d’un poème symphonique, Scènes héroïques, composé en l’honneur de Lille et Échec et mat. Puis, en 1907, Le dragon vert (opéra) avec Henry Gauthier-Villars.
En 1884-1886, mentionné comme commis principal au service des procès-verbaux du Sénat. Entre au compte rendu analytique en 1891. Président (au moins à la fin de la décennie) de « L’Hémicycle », société de vélocipédie des deux assemblées (regroupant pour l’essentiel des journalistes parlementaires, semble-t-il), il est nommé membre du comité d’organisation des démonstrations et concours de vélocipédie pour l’Exposition universelle de 1900.
Gendre d’Emile Burnouf, spécialiste du sanscrit et directeur de l’École française d’Athènes.
Lucien (Mercier) de SAINTE-CROIX
(Saint-Bauzel, Tarn-et-Garonne, 1861 – 1939). Avocat, docteur en droit. Sa thèse portait sur L’exception de dol en droit romain et sur La déclaration de guerre et ses effets immédiats. Cette dernière étude de législation comparée, publiée en 1892, reçut un accueil assez large. L’auteur y est présenté comme « ancien élève de l’École des sciences politiques et de l’École pratique des hautes études ». C’est d’ailleurs en 1892 qu’il serait entré au compte rendu, pour combler les vacances creusées en cinq mois par les décès de Lapommeraye, Lescure et Ceyras. Mentionné en 1918 comme chef du service.
Il semble avoir largement abandonné par la suite les sujets juridiques pour d’autres à la limite de la sociologie et de l’ethnographie, encore qu’on n’y discerne pas une grande unité. En 1895, il collaborait au Mouvement social. En 1897, il contribuait aux Études sur les populations rurales de l’Allemagne et la crise agraire, de Georges Blondel. Il s’intéresse également, vers cette époque, à Madagascar et à l’histoire du royaume hova et est membre de la société de géographie commerciale. Au Mercure de France, il donne des articles substantiels sur Camille Jullian (1890), Blasco Ibañez (1922), Émile Mâle (1927) et c’est dans les actes du Congrès archéologique de 1940 qu’on a trouvé l’annonce de sa mort, survenue depuis le congrès de l’année précédente.
Pierre MAUBRAC
(Bordeaux, 1860 – Vanves, 1916). Sans Servir les Assemblées, je n’aurais pas fait le lien entre le fonctionnaire dont le nom figure en premier sur le monument aux morts du Sénat et le médecin-chef de l’hôpital militaire de Vanves assassiné par son subordonné en 1916, tant sont rares les mentions de cette double carrière.
Au sortir de l’école d’application du Val-de-Grâce, il fut affecté à l’hôpital militaire du Gros-Cailllou (1884), servit ensuite en Tunisie (1886-1890) avant de rentrer en métropole. Reçu au compte rendu analytique en 1892, en même temps que Delorme, il fut versé dans la réserve mais conjugua son service au Sénat avec une activité libérale restreinte, dans le cabinet qu’il avait ouvert rue de Prony (Le Journal du 29 août 1916). Déjà auteur de plusieurs ouvrages de technique chirurgicale (sur les luxations, sur les plaies de l’artère fémorale…), il publia encore en 1896, en collaboration avec un fils de Paul Broca, un Traité de chirurgie cérébrale. Mobilisé en 1914, il fut d’abord envoyé à l’hôpital-ambulance de Nancy puis, médecin-major à cinq galons, nommé à la tête de l’hôpital d’instruction installé dans le lycée Michelet de Vanves. Là, il entra aussitôt en conflit avec un sergent-infirmier qui, en place depuis plus longtemps, acceptait mal son autorité. Probablement instable, ce dernier lui ira trois coups de revolver avant de se tuer lui-même. Maubrac fut fait officier de la Légion d’honneur à titre posthume.
Émile DELORME
(Aisne, 1866-1924). Licencié en droit. Entre au compte rendu en juillet 1892. En 1894, il épouse la fille de Charles Simon. Lieutenant de réserve, il assure le secrétariat de la commission de l’armée. Les seules autres mentions de lui qu’on ait trouvées concernent la vie familiale des Simon ou des contributions à la Revue politique et parlementaire.
Georges BARATIER
(Bayonne, 1868- 1911), fils d’un intendant général, directeur du service de l’intendance du gouvernement militaire de Paris, est lui-même saint-cyrien (1888) et sous-lieutenant de dragons (au moins de 1892 à 1895). En 1911, la presse annonce la mort du secrétaire-rédacteur, enlevé par une péritonite à 42 ans, en précisant qu’il était le frère du colonel “connu pour sa participation à la mission Marchand”. Georges Baratier était entré au compte rendu en 1895 ou 1896 (en remplacement de Monnet ?).
Jules LAÎNÉ
(Paris, 1877-1962). Études de lettres, puis diplôme de l’École libre des sciences politiques et licence de droit. Entre au compte rendu en décembre 1900. Réformé, il est le seul (?) à assurer le secrétariat des commissions pendant la guerre de 1914-18. Chef adjoint en 1927, chef en 1930.
Pierre de LAPOMMERAYE

(Paris, 1874-1962) était le fils d’Henry. Il semble qu’il ait été tenté de prendre la succession de celui-ci : il est mentionné comme secrétaire de rédaction du Paris en 1897 et on a la trace d’au moins une conférence, sur Dorchain, en 1899. Surtout, il entre au compte rendu analytique, en 1903 au plus tard. Il prendra la tête du service en 1927 et sera nommé secrétaire général en 1930. Il occupera le poste jusqu’en 1942. À la Libération, témoignera aux procès Pétain et Laval.
Sa passion n’était pas comme son père le théâtre : de 1919 jusqu’en 1930, il tint une chronique musicale dans Le Ménestrel. Mais est-ce bien lui qui, comme le suggère le sous-titre, avait servi de modèle à Renoir, en 1875-76, pour L’enfant à la poupée de Polichinelle ?
Édouard CABIBEL
(Mazamet, 1875 – Mazamet, 1907). Études de droit à Toulouse ; mentionné encore dans un annuaire de 1908.